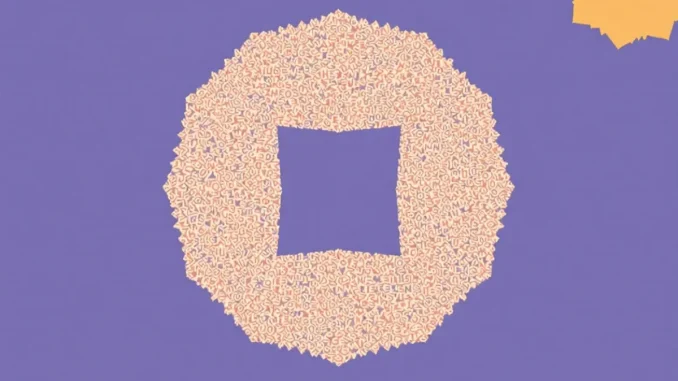
La confiscation partielle constitue une sanction pénale singulière dans l’arsenal juridique français, permettant aux magistrats d’ordonner la saisie d’une fraction des biens d’un condamné. Cette mesure, distincte de la confiscation totale, s’inscrit dans une logique d’individualisation des peines et de proportionnalité. Son application soulève des questions complexes touchant tant aux droits fondamentaux qu’à l’efficacité répressive. Entre protection du droit de propriété et nécessité de sanctionner efficacement certaines infractions, la confiscation partielle navigue sur une ligne de crête juridique délicate, dont les contours méritent d’être précisés à la lumière des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes.
Fondements juridiques et évolution historique de la confiscation partielle
La peine de confiscation trouve ses racines dans l’ancien droit français où elle constituait une sanction redoutable, souvent associée aux crimes de lèse-majesté. La Révolution française a tenté de limiter son application avant que le Code pénal de 1810 ne la réintroduise sous une forme encadrée. La notion spécifique de confiscation partielle s’est progressivement construite au fil des réformes pénales du XXe siècle.
Le cadre légal contemporain de la confiscation partielle repose principalement sur l’article 131-21 du Code pénal, modifié par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes et la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines. Ces textes ont considérablement élargi le champ d’application de cette mesure, tout en précisant ses modalités d’exécution.
La confiscation partielle se distingue juridiquement de la confiscation totale par son étendue limitée. Elle permet au juge de cibler spécifiquement certains biens du condamné, sans nécessairement le priver de l’intégralité de son patrimoine. Cette nuance s’avère fondamentale dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction.
Typologie des confiscations en droit français
Le système juridique français distingue plusieurs formes de confiscation :
- La confiscation de l’instrument de l’infraction
- La confiscation du produit direct ou indirect de l’infraction
- La confiscation en valeur
- La confiscation élargie pour certaines infractions graves
La confiscation partielle peut s’appliquer à chacune de ces catégories. Le législateur a progressivement affiné ce dispositif, notamment avec la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, qui a renforcé les possibilités de confiscation partielle dans les affaires de criminalité économique et financière.
L’évolution jurisprudentielle a joué un rôle majeur dans la définition des contours de cette peine. La Cour de cassation, par un arrêt de principe du 27 mars 2018, a confirmé que la confiscation partielle devait respecter le principe de proportionnalité et tenir compte de la situation personnelle du condamné. Cette position a été confortée par la jurisprudence européenne, notamment dans l’arrêt Gogitidze c. Géorgie de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 12 mai 2015, qui admet la confiscation partielle comme mesure légitime de politique criminelle sous réserve de garanties procédurales suffisantes.
Régime juridique de la confiscation partielle en droit positif
Le régime juridique de la confiscation partielle se caractérise par une dualité fonctionnelle : elle constitue à la fois une peine complémentaire et une mesure de sûreté. Cette double nature juridique influence directement ses conditions d’application et son régime d’exécution.
En tant que peine complémentaire, la confiscation partielle doit être expressément prévue par le texte d’incrimination. Elle s’applique principalement aux délits et aux crimes, mais certaines contraventions de cinquième classe peuvent également être assorties d’une telle mesure. Le juge pénal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer l’étendue exacte de la confiscation, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du délinquant.
La procédure de confiscation partielle implique plusieurs étapes distinctes :
- L’identification précise des biens susceptibles de confiscation
- L’évaluation de leur valeur
- La détermination de la fraction à confisquer
- Le prononcé de la mesure dans le jugement de condamnation
Conditions d’application spécifiques
Pour ordonner une confiscation partielle, le tribunal doit respecter plusieurs conditions cumulatives. D’abord, la confiscation doit concerner des biens dont le condamné est propriétaire ou, sous certaines conditions, dont il a la libre disposition. Ensuite, le juge doit motiver spécialement sa décision lorsqu’il ordonne la confiscation d’un bien qui n’est pas directement lié à l’infraction.
La jurisprudence a progressivement affiné ces critères. Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que la confiscation partielle devait être motivée au regard de la situation familiale et sociale du condamné. Cette exigence de motivation spéciale constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire.
Les biens susceptibles de confiscation partielle sont variés : immeubles, véhicules, comptes bancaires, portefeuilles d’actions, voire fonds de commerce. La loi LOPPSI II du 14 mars 2011 a étendu les possibilités de confiscation aux biens dont le condamné a la libre disposition, même s’il n’en est pas formellement propriétaire. Cette extension vise à contrer les stratégies d’organisation d’insolvabilité.
L’exécution de la confiscation partielle relève de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), créée par la loi du 9 juillet 2010. Cet organisme public spécialisé assure la gestion des biens confisqués jusqu’à leur vente ou leur attribution définitive. Le produit des ventes est généralement versé au budget général de l’État, mais peut parfois alimenter le fonds de concours de la police ou de la gendarmerie nationale.
Champ d’application matériel de la confiscation partielle
Le champ d’application matériel de la confiscation partielle s’est considérablement élargi ces dernières années, reflétant une volonté politique de renforcer l’arsenal répressif contre certaines formes de criminalité particulièrement lucratives. Cette peine trouve désormais application dans des domaines variés du droit pénal.
En matière de trafic de stupéfiants, la confiscation partielle constitue un outil privilégié pour priver les délinquants d’une partie des profits illicites. L’article 222-49 du Code pénal prévoit spécifiquement cette possibilité, permettant aux magistrats de cibler avec précision les avoirs acquis grâce au trafic. La jurisprudence a confirmé que cette confiscation pouvait s’étendre aux biens dont l’origine licite ne pouvait être démontrée par le condamné, instaurant ainsi une forme de renversement de la charge de la preuve.
Dans le domaine de la délinquance économique et financière, la confiscation partielle joue un rôle majeur. Les infractions comme le blanchiment d’argent, la corruption, la fraude fiscale ou les abus de biens sociaux peuvent donner lieu à des mesures de confiscation ciblées. La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a renforcé ces dispositifs, permettant notamment la confiscation partielle du patrimoine inexpliqué.
Cas particuliers d’application
Certaines infractions font l’objet d’un régime spécifique en matière de confiscation partielle :
- Pour le proxénétisme, l’article 225-24 du Code pénal prévoit la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction
- En matière de terrorisme, l’article 422-6 permet une confiscation étendue
- Pour les infractions au Code de l’environnement, la confiscation peut viser les instruments de l’infraction
La criminalité organisée fait l’objet d’un traitement particulier, avec des possibilités élargies de confiscation partielle. Le Code de procédure pénale, dans ses articles 706-103 et suivants, prévoit des mécanismes spécifiques de saisie patrimoniale préalable pour garantir l’effectivité ultérieure de la confiscation.
L’application de la confiscation partielle aux personnes morales présente des caractéristiques propres. Une entreprise condamnée pénalement peut voir une partie de ses actifs confisqués, ce qui soulève des questions délicates quant à la continuité de l’activité économique et la protection des emplois. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2020, a précisé que cette confiscation devait tenir compte de l’impact économique et social potentiel, consacrant ainsi une approche pragmatique.
La dimension internationale ne peut être négligée. Les conventions internationales comme la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée ou la Convention de Mérida contre la corruption prévoient des mécanismes de coopération pour l’exécution transfrontalière des mesures de confiscation. Le droit de l’Union européenne, notamment avec la Directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime, a harmonisé les pratiques nationales en la matière.
Garanties procédurales et droits fondamentaux
La mise en œuvre de la confiscation partielle doit s’accompagner de garanties procédurales solides pour assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Cette exigence découle tant du droit interne que des engagements internationaux de la France.
Le principe du contradictoire constitue la première garantie essentielle. La personne visée par une mesure de confiscation partielle doit pouvoir discuter la légalité et l’opportunité de cette mesure avant son prononcé. Cette exigence a été renforcée par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, qui a précisé les droits de la défense en matière de saisies et confiscations.
Le droit de propriété, protégé tant par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, impose des limites à l’action des autorités. La confiscation partielle, en tant qu’atteinte à ce droit, doit répondre à trois critères cumulatifs :
- Une base légale claire et accessible
- Un but légitime d’intérêt général
- Une proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi
Contrôle juridictionnel et voies de recours
Le contrôle juridictionnel joue un rôle crucial dans l’encadrement de la confiscation partielle. Les décisions ordonnant une telle mesure peuvent faire l’objet de différentes voies de recours :
L’appel permet de contester la décision de première instance devant la cour d’appel. Le pourvoi en cassation offre la possibilité de soulever des questions de droit devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée si la disposition législative fondant la confiscation est suspectée de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La jurisprudence constitutionnelle a précisé les contours de ces garanties. Dans sa décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que la confiscation devait respecter le principe de nécessité des peines. Plus récemment, dans sa décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, il a validé le régime de confiscation partielle sous réserve d’une motivation suffisante par le juge.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) exerce un contrôle complémentaire. Dans l’arrêt Grifhorst c. France du 26 février 2009, elle a sanctionné une confiscation disproportionnée au regard de la gravité de l’infraction. À l’inverse, dans l’affaire Phillips c. Royaume-Uni du 5 juillet 2001, elle a admis la compatibilité de certaines présomptions facilitant la confiscation avec les exigences du procès équitable.
Les tiers de bonne foi bénéficient d’une protection spécifique. L’article 131-21 alinéa 3 du Code pénal précise que la confiscation ne peut porter sur les biens dont un tiers, étranger à l’infraction, peut justifier la propriété légitime. Cette disposition protège notamment les créanciers hypothécaires, les copropriétaires ou les conjoints du condamné. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2022, a rappelé que ces tiers pouvaient intervenir à la procédure pour faire valoir leurs droits.
Défis pratiques et perspectives d’évolution de la confiscation partielle
La mise en œuvre effective de la confiscation partielle se heurte à plusieurs défis pratiques qui limitent parfois son efficacité. Ces obstacles, de nature diverse, appellent des réponses adaptées et ouvrent la voie à des perspectives d’évolution du dispositif.
L’identification précise des avoirs saisissables constitue le premier défi majeur. Malgré les progrès réalisés, les enquêteurs financiers se heurtent souvent à des montages complexes visant à dissimuler le patrimoine réel. Les sociétés écrans, les prête-noms ou le recours à des paradis fiscaux compliquent considérablement le travail d’investigation patrimoniale. La coopération internationale demeure insuffisante dans certaines régions du monde, créant des zones de refuge pour les avoirs illicites.
L’évaluation de la valeur des biens pose également des difficultés techniques. La détermination précise de la fraction à confisquer nécessite une expertise fiable, particulièrement pour des biens atypiques comme les œuvres d’art, les cryptomonnaies ou certains actifs incorporels. Le recours aux experts judiciaires génère des coûts significatifs et allonge les délais de procédure.
Innovations et réformes envisageables
Face à ces défis, plusieurs pistes d’amélioration se dessinent :
- Le renforcement des moyens humains et techniques dédiés aux investigations patrimoniales
- La création d’une base de données centralisée des avoirs criminels
- L’amélioration des mécanismes d’entraide judiciaire internationale
La digitalisation des procédures offre des perspectives prometteuses. L’utilisation de technologies blockchain pourrait faciliter le traçage des transactions financières suspectes. Les algorithmes d’intelligence artificielle permettraient d’analyser rapidement de grands volumes de données financières pour détecter des schémas de blanchiment. Ces innovations technologiques doivent toutefois s’accompagner de garanties adaptées en matière de protection des données personnelles.
Sur le plan législatif, plusieurs évolutions sont envisageables. L’extension du renversement de la charge de la preuve, déjà appliqué pour certaines infractions graves, pourrait être élargie à d’autres domaines de la criminalité économique. Une meilleure articulation entre les procédures pénales et fiscales faciliterait l’identification des avoirs susceptibles de confiscation. La création d’une procédure spécifique de confiscation non conviction based, indépendante d’une condamnation pénale, comme elle existe dans les systèmes de common law, fait l’objet de débats.
L’harmonisation des pratiques au niveau européen progresse, notamment avec le Parquet européen opérationnel depuis juin 2021, qui dispose de compétences en matière de gel et de confiscation d’avoirs. Le règlement (UE) 2018/1805 relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation renforce l’efficacité transfrontalière de ces mesures.
La dimension sociale de la confiscation mérite une attention particulière. La réaffectation des biens confisqués à des projets sociaux ou à l’indemnisation des victimes, plutôt qu’au budget général de l’État, pourrait renforcer l’acceptabilité sociale de cette peine. Certains pays, comme l’Italie avec la loi La Torre, ont développé des modèles innovants de réutilisation sociale des biens confisqués à la mafia, transformant d’anciennes propriétés criminelles en centres culturels ou en coopératives agricoles.
L’avenir de la confiscation partielle s’inscrit dans une tendance plus large de patrimonialisation de la répression pénale. Cette évolution, qui vise à frapper les délinquants « au portefeuille », répond à une attente sociale forte mais soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre efficacité répressive et protection des libertés. Le défi des prochaines années consistera à affiner cet outil pour en faire un instrument de justice à la fois efficace et respectueux des droits fondamentaux.

